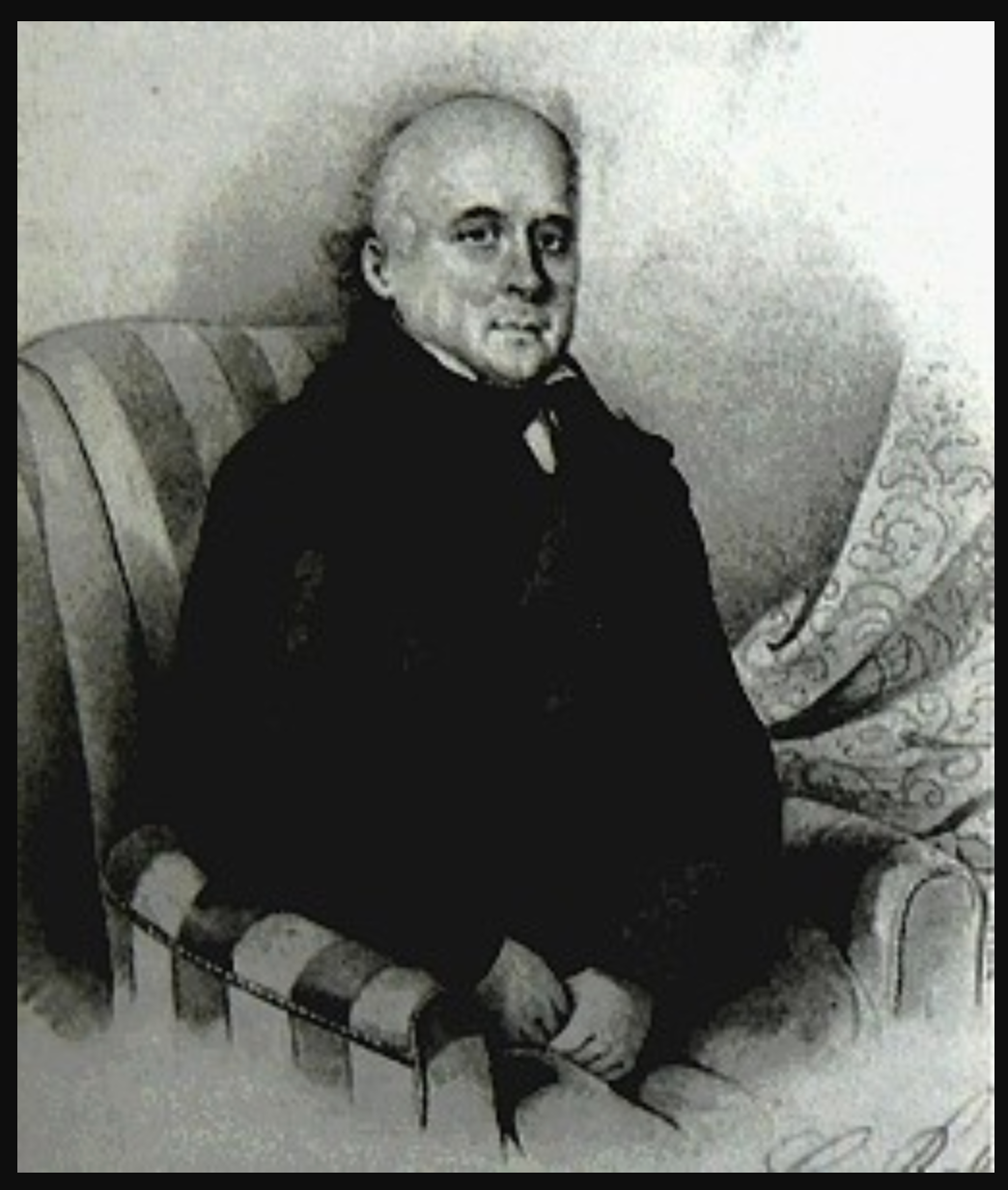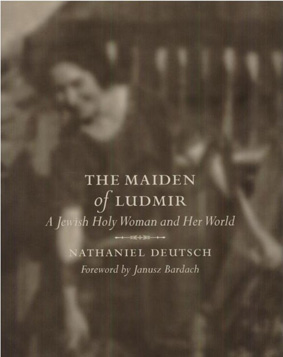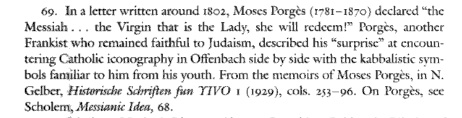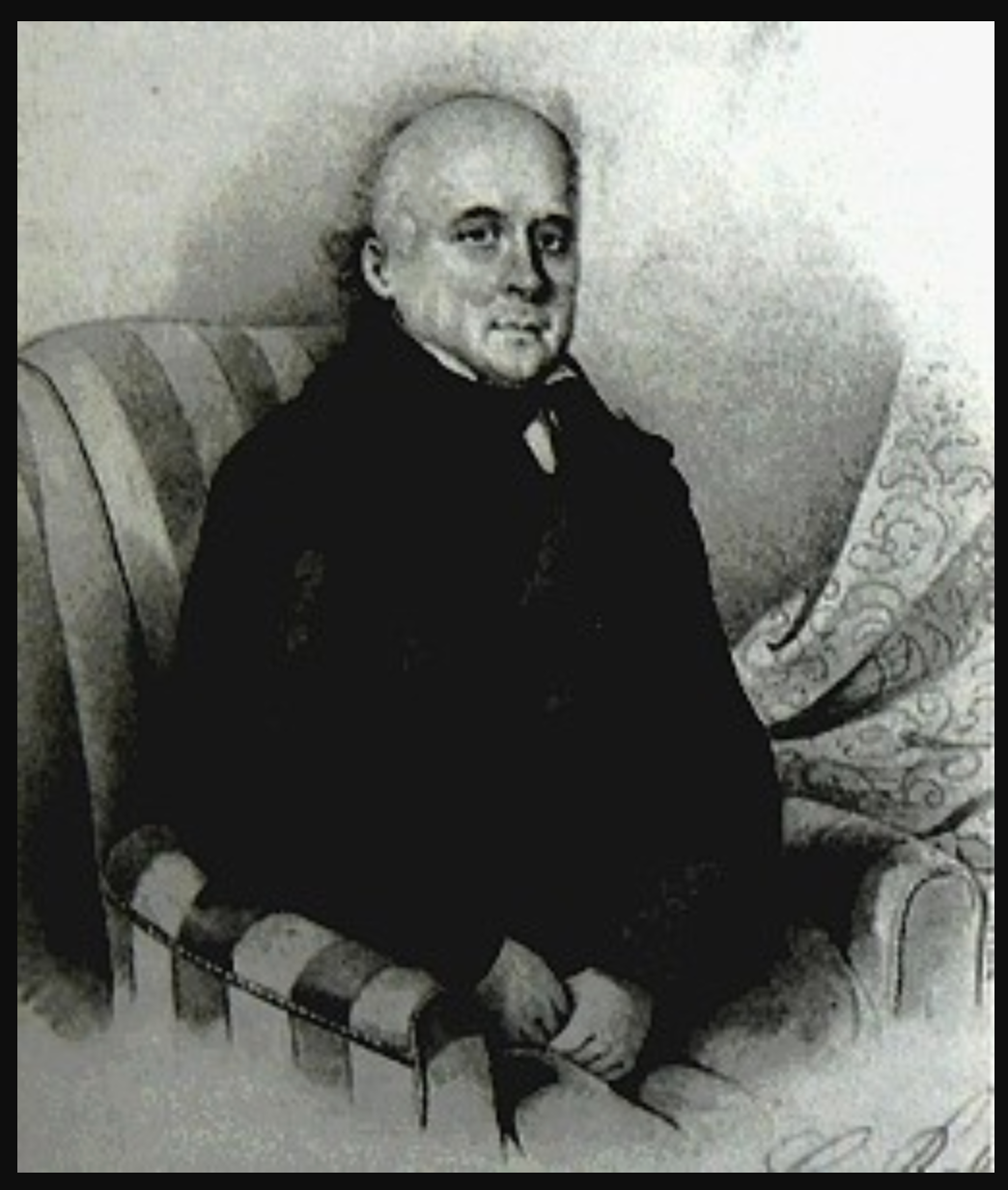
Moses Porges |

Juda Leopold Porges |
Je suis né le 22 décembre
1781.
Mon père, Morene Rabbi Gabriel PORGES, un érudit dans
tous les domaines du savoir Juif était un homme vertueux
et honnête.
Les sciences chrétiennes, peu connues des
érudits Juifs de ce temps, ne lui étaient pas étrangères.
C'était un homme bon et aimable, qui n'avait jamais fait
subir à ses enfants de châtiments corporels.
Ma mère
était une femme au cœur d'or, qui gérait les
affaires dont nous vivions (fabrication d'essences de plantes et
de fruits et vente d'eau-de-vie).
Mon père s'en occupait
peu.
Il consacrait son temps aux études et donnait des conférences.
Comme c'était la coutume à cette époque, on
m'enseigna l'hébreu et la traduction de la bible.
À
l'âge de sept ans, j'entrai à l'école israélite
allemande, que je quittai dès l’âge de onze ans.
À cause de mon caractère très vif, je fréquentais
peu l'école.
En été, au lieu d'aller en classe,
j'allais me baigner dans la Moldau, et en hiver je faisais du patin
à glace.
Après avoir quitté l'école,
je voulais étudier, mais mon frère aîné,
étudiant en philosophie, y était opposé et
influença mes parents afin qu'ils ne m'y autorisent pas.
Je me trouvai donc sans occupation et sans enseignement.
Grâce
à l'aide de ma chère mère, je pus me procurer
des livres de Lessing, Mendelssohn, Schiller, et également
de Cramer, Spiess et d'autres encore, notamment en l'histoire et
géographie.
C'est ainsi, grâce à cet auto-enseignement,
que j'ai pu m'instruire.
Lorsque j'eus quatorze ans, mon père bien-aimé m'appela
dans sa chambre et me demanda d'un ton solennel si je pensais que
la Torah révélée contenait tout ce qu'il était
nécessaire de connaître pour notre salut spirituel
et notre félicité ici bas et dans l'au-delà.
J'étais jusqu'alors un Juif orthodoxe, même si j'avais
certains doutes et certaines hésitations.
Il me dit d'un
ton cérémonieux :
"
À côté
de la Torah, il y a un livre saint, le Zohar, qui nous révèle
des secrets qui ne sont qu'ébauchés dans la Torah,
qui nous invite à un perfectionnement spirituel et qui indique
comment y parvenir.
Beaucoup de cœurs nobles se consacrent
à ce nouvel enseignement, dont le but est la libération
d'une pression spirituelle et politique.
"
Dieu s'est révélé,
de mon temps comme jadis.
Mon fils, tu dois être mis au courant
de tout.
Monsieur Noa Kassowitz, un des nôtres, se chargera
de ton enseignement.
Je fondis en larmes et embrassai la main de
mon père un grand nombre de fois.
Je le quittai comme ivre,
me sentant plus élevé et appartenant désormais
à une classe plus noble.
Bien qu'il soit superflu de rentrer ici dans le détail de
l'enseignement de Kassowitz, il faut cependant que je vous dise
un peu ce qu'il m'apprit.
Ces derniers temps, m'expliqua-t-il, un envoyé de Dieu, du
nom de Jacob FRANK, appelé également Censlochowa,
natif de Pologne et ayant séjourné un certain temps
en Turquie, s'est déclaré être le Messie.
Il
a rassemblé autour de lui de nombreux érudits Juifs
renommés qui le vénèrent et l'adorent.
Il s'est
attaché de nombreux disciples par ses prophéties,
ses promesses de délivrance spirituelle et corporelle et
surtout par la promesse d'une vie éternelle.
Dès qu'elles
en ont été informées, les autorités
l'ont condamné à une peine d'emprisonnement.
Il a
passé pas mal de temps à la forteresse Censtochan.
Dès qu'il fut libéré, il se convertit au christianisme,
avec sa famille et la plupart de ses disciples, afin de libérer
les schrins, (esprit sain "sic") tenus prisonniers
par Rome.
Quelque temps plus tard, il réapparut à Prassnitz
en Moravie dans toute sa splendeur et sa magnificence, sous le nom
de Baron Frank.
Il avait même des gardes du corps qui le protégeaient
lors de ses déplacements.
On sait que l'Empereur Joseph II
lui rendit visite.
De Prassnitz, il déménagea à
Offenbach où il emménagea dans une maison à
lui, entouré de nombreux partisans, en majorité Polonais.
La conversion à une autre confession est un acte majeur,
qui modifie profondément le cours de la vie du converti.
Si cette démarche est guidée par la conviction, on
peut la considérer comme honorable ; mais si c'est par aveuglement
passionnel, elle peut conduire au malheur, et aux regrets amers
lorsque la passion s'est calmée pour faire place à
une réflexion sereine.
À son décès, sa fille prit la tête des
fidèles, sous le nom de Gewira.
Elle n'était plus
très jeune et ses deux frères Roch et Joseph se tenaient
à ses côtés.
Il est difficile à décrire l'impression que ses révélations
firent sur moi, jeune homme plein de vie et en quête de vérité.
Je fus pris d'un désir si ardent du lieu saint que je n'avais
plus ni tranquillité, ni d'autre pensée que de partir
là-bas.
Seulement, comment l'entreprendre ce voyage, puisque
je n'en avais pas les moyens et que mon bon père n'était
pas en mesure de me les procurer.
Je profitai d'un recrutement général en 1798, où
l'on sortait les jeunes gens de leur lit en pleine nuit, pour me
cacher chez des amis (Salomon Brandeis).
Après quelques semaines,
afin d'écarter tout danger, on décida que j'émigrerais
en Allemagne.
Comme cela n'était pas légalement possible,
un marchand de Taglitz, du nom de Katz, devait m'emmener à
Taglitz.
Il m'attendait devant la porte de Strafon.
Arrivé
à Taglitz, on m'envoya chez un vieux Juif de Sobotan qui
pouvait, par des chemins de contrebandiers, me mener jusqu'en Saxe
par la montagne.
Il demanda pour çà 2 florins et 1
écu, que je lui donnai volontiers.
Me voici donc au sommet du Geiersberg.
Tout seul à 17 ans,
loin de tous, au milieu de la forêt, alors que j'étais
habitué à vivre au sein d'une famille aimante, dorloté
par la douce main maternelle.
Je me mis à pleurer.
Cependant
je trouvai une consolation dans le but du voyage que j'avais entrepris
vers Offenbach.
Est-ce que les souffrances et les privations subies
compteraient comme épreuve de ma foi dans mon nouvel enseignement?
J'avais reçu de ma famille une somme de 60 florins en or
et en argent.
J'avais en plus à peu près 3 florins
en petite monnaie, et, dans la ferveur de ma foi, je fis alors le
serment de payer mon voyage à Offenbach avec ces 3 florins,
dussé-je avoir faim ou mendier, pour apporter en offrande
les 60 florins à la divine maîtresse.
Plein de courage et de détermination, je continuai mon chemin
et arrivai le soir à Fürstenau, un petit village saxon.
Après un dîner frugal, on m'arrangea dans la vaste
salle de l'auberge une couche de paille où, très fatigué,
je m'étendis et m'endormis rapidement.
Vers minuit un vacarme
me réveilla ; un homme, auquel mon imagination donna la taille
d'un géant, entra dans la salle muni d'un énorme bâton
et portant un ballot sur le dos.
Derrière lui il y en avait
un semblable, et puis d'autres jusqu'à ce que la salle de
l'auberge fut remplie.
J'avais peur comme un jeune homme de 17 ans
qui n'a pas encore beaucoup vécu.
Une heure plus tard, après
avoir bu force bière et eau-de-vie, ils quittèrent
l'auberge.
J'appris plus tard que c'étaient des contrebandiers.
Le matin, je continuai mon voyage pour Dresde.
À l'entrée
de la ville, j'eus la désagréable et blessante surprise
d'avoir à payer une taxe corporelle.
Dans presque toute l'Allemagne,
on devait payer, tout comme pour les bestiaux, une taxe corporelle
pour le bonheur d'être né Juif.
On fouilla ensuite
mon sac de voyage.
Le préposé y découvrit un
bonnet de nuit neuf, jamais utilisé, pour lequel il me fit
payer la douane et une amende pour ne pas l'avoir déclaré.
Tout cela entama sérieusement mon petit capital.
J'avais
été recommandé à Dresde à l'un
des nôtres, un certain Monsieur Eibenschütz.
C'était
un jeune homme assez beau, mais sourd et bègue au point qu'il
était presque impossible de le comprendre.
Après avoir
lu la lettre de recommandation, il m'accueillit très chaleureusement
en m'embrassant et en me serrant la main.
Pendant mon séjour
à Dresde, il m'offrit le gîte et le couvert et me procura
un passeport de sujet saxon, pour m'épargner la taxe corporelle
des Juifs.
Je restai à Dresde pour les fêtes de Pâques.
Au moment des adieux, l'aimable et bon Monsieur Eibenschütz
me donna deux écus.
Je quittai Dresde par un superbe temps de printemps.
Je continuai
mon voyage pour Offenbach à pied, enivré et exalté
par le but que je poursuivais.
Au début, malgré le
poids de mon sac de voyage, je marchais léger et chantant.
J'arrivai le soir à Meissen où, après avoir
dîné, je m'endormis sur une couche de paille.
Mes pieds
étaient douloureux et blessés, et lorsque je me levai,
mais il me fut impossible de marcher et de remettre mes chaussures.
Triste situation lorsque l'on court impatiemment vers un tel but.
Je n'avais pas d'autre solution que de marcher pieds nus et de poursuivre
mon chemin vers Leipzig avec des pieds douloureux et gonflés.
J'y arrivai le troisième jour.
Je passai les nuits précédentes
à Oschatz et Wurzen.
On ne m'autorisa pas à passer
par Leipzig, où un policier me fit contourner la ville sur
la route de Weimar.
Je parcourus cette route péniblement,
accablé par la douleur et la faim et, découragé
et faible, je finis par m'affaisser sur la chaussée.
Au bout
d'une heure, une calèche arriva de Leipzig ; lorsqu'elle
fut assez proche je fis un effort pour me relever et m'aperçus
qu'elle était vide.
Je demandai au cocher où il allait.
" À Weimar " me dit-il.
" Moi aussi! Pouvez-vous m'emmener ? " -
" Oui " fit-il.
" Combien cela coûtera-t-il ?" demandai-je, "Je
suis pauvre et ne peux pas payer beaucoup!"
" Monte, nous nous arrangerons!"
Je mis mon sac de voyage
dans la voiture et montai. La voiture démarra et poursuivit
sa route.
Quel délice, après avoir souffert tant de
tourments, que de voyager dans une voiture aussi confortable et
de penser aux 12 lieues que j'allais parcourir si agréablement!
La nuit était tombée quand nous arrivâmes à
Weissenfels.
Le cocher s'arrêta dans un hôtel.
Deux
garçons, un candélabre à la main, arrivèrent
pour m'aider à sortir de la voiture.
Lorsqu'ils me virent
descendre, l'un d'eux dit :
" Sa place est à l'auberge,
pas ici! ".
Le brave cocher m'indiqua le chemin et promit de
venir me chercher tôt le lendemain matin.
Mon repas du soir
consista en un morceau de pain noir et un verre de bière.
Je dormis toute la nuit d'une traîte sur ma couche de paille,
et me levai tôt après avoir repris des forces.
Je n'attendis
pas longtemps avant que mon cocher arrivât.
Je mis mon sac
de voyage dans la voiture, montai derrière et nous voilà
repartis.
Le soir nous nous arrêtâmes dans un village
pour y passer la nuit.
Le lendemain nous reprîmes notre route
pour arriver à Weimar vers 10 heures.
À l'approche
de la ville, le cocher me fit descendre.
Je sortis mon bagage et
descendis de la voiture avec hésitation.
Qu'allait me demander
le cocher pour le voyage?
Je lui demandai timidement ce que je lui
devais.
Il m'est difficile de dire quelles furent ma surprise et
ma joie lorsque l'aimable cocher ne me demanda que 20 Kreutzer,
en me faisant remarquer qu'il ne me demandait que ce qu'il avait
déboursé pour moi.
Je passai par Weimar sans m'y arrêter,
puis par Erfurt et arrivai le soir à Gotha.
J'entrai dans
une auberge où je demandai de la bière et du pain.
Dans une pièce contiguë,il y avait une table dressée
pour de nombreux convives et il y régnait un air de fête.
On apporta des rôtis, des gâteaux, des fruits et divers
autres mets.
On fêtait le baptême d'un enfant. Je n'avais
pas mangé de viande depuis Dresde.
Ces odeurs de nourriture
m'excitaient.
La patronne vient alors près de moi et me dit
:
" Je vois bien que tu es le fils de braves gens" ;
et
me tendit une assiette pleine de rôti, d'œufs et de pâtisserie.
Le lendemain après-midi j'arrivai aux portes d'Erfurt.
Il
y avait alors une garnison autrichienne.
On m'arrêta pour
me faire payer une taxe corporelle de 2 florins.
Toute discussion
était inutile, de même que ma proposition de ne pas
passer par Erfurt.
Mon bagage fut confisqué.
Finalement le
receveur accepta de me conduire devant le capitaine de la ville.
Un soldat m'y amena.
Le capitaine n'était pas chez lui, mais
en visite chez une Baronne.
Je demandai que l'on me conduisit jusqu'à
lui.
Il me demanda ce que je désirai et je lui dis que je
trouvai injuste de réclamer 2 florins de taxe corporelle
à un malheureux voyageur sous prétexte qu'il était
de confession juive.
Il me répondit que c'était la
loi du pays.
Ce à quoi je rétorquai :
" Je comprends
que le receveur puisse dire çà, mais vous, un haut
fonctionnaire éclairé, admettez que cette taxe est
destinée aux Juifs qui font des affaires et du commerce et
pas aux pauvres voyageurs de passage."
Comme le capitaine continuait
à faire des difficultés, la Baronne prit la parole
et dit en français :
" Ce jeune homme a raison ; il est
cruel de réclamer une somme aussi importante."
Sur ce,
le capitaine me donna un document manuscrit qui m'exonéra
de toute taxe.
J'arrivai le soir à Gotha.
Je poursuivis mon
chemin vers Offenbach par Eisenach, à travers la Hesse jusqu'à
Hanau où j'arrivai en milieu de journée sans autres
aventures.
L'espoir d'arriver le jour même dans la soirée
à Offenbach me fit accélérer le pas.
J'étais
dans un état d'excitation indescriptible.
Le rassemblement
des fidèles à Offenbach s'appelait "Machine"
et "Camp" par référence au camp des Israélites
sous Moïse.
Je devais le jour même faire mon entrée
et être accueilli dans cette "Machine".
Il faisait déjà sombre lorsque j'arrivai le soir à
Offenbach, ville ouverte.
Il pleuvait.
Je demandai la ferme polonaise.
On m'envoya à l'autre bout de la ville.
Une maison imposante.
Je pleurai dans un recueillement religieux.
Je montai quelques marches
et tirai la cloche.
Un jeune homme en habits turcs m'ouvrit et me
souhaita la bienvenue, me serra dans ses bras, m'embrassa, me nomma
frère et me dit que l'on m'attendait.
Plusieurs Maminim
se rassemblèrent, dont un vieil homme d'allure respectable,
aux cheveux blancs comme neige, en uniforme de capitaine, de nom
de Cinsky.
Il me conduisit dans sa chambre au deuxième étage.
Il m'assura qu'il me prodiguerait à tout moment ses conseils
paternels puis m'indiqua comment me comporter lors de l'audience
prévue chez la Sainte Mère. Le même soir, beaucoup
de Maminim me rendirent encore visite, des vieux comme des
jeunes.
Le lendemain je fus appelé pour l'audience chez la Gewira.
Elle habitait le deuxième étage.
Une femme de chambre
m'accueillit dans le vestibule, où je l'on me fit attendre
quelque temps.
Que j'étais ému et comme mon cœur
battait!
Finalement une porte s'ouvrit et j'entrai.
Je n'osai pas
regarder la Gewira en face, m'agenouillai devant elle et lui embrassai
le pied comme on me l'avait prescrit.
Elle me dit quelques mots
gentils, loua mon père et me félicita aussi sur ma
décision de venir ici.
Quand je me retirai, je déposai
sur la table ma petite bourse, qui contenait environ 60 florins
en or et en argent, et sortis à reculons.
La Gewira me fit
une impression de noblesse des plus favorables.
Son joli visage
exprimait bonté et douceur, et ses yeux exprimaient une sainte
exaltation.
Elle n'était plus toute jeune, mais avait une
apparence charmante.
Des mains et des pieds adorables.
Comme je
l'appris plus tard, je trouvai grâce à ses yeux.
Sur
ordre supérieur, je fus comme la plupart des jeunes gens
affecté à la Siberia, ce qui consistait à servir
les trois maîtres à table, lors de leurs sorties quotidiennes
et le dimanche à l'église.
Nous habitions dans la
même chambre. Cela me donnait l'occasion, surtout à
table, d'observer les maîtres de près.
Je reçus
un uniforme de chasseur et une casquette de cuir vert avec garniture
métallique en guise de chapeau.
Appartenir à ce corps
était considéré comme un grand honneur.
Je
servais souvent à table et je devais me tenir derrière
la chaise de la Gewira.
La salle où l'on prenait les repas
était assez spacieuse.
Nous étions trois à
être affectés au service des trois maîtres, et
nous avions le droit de consommer les restes de nourriture après
les repas.
Comme tous les occupants de la maison, devaient aller
chercher leur repas de midi à la cuisine communautaire, et
que le déjeuner consistait en une soupe et un légume
de très mauvaise qualité, nous apprécions tout
particulièrement notre nourriture.
Chaque dimanche il y avait
la parade à l'église, à laquelle devaient participer
tous ceux qui portaient un uniforme.
Je ne fréquentais que
mes coreligionnaires, et surtout les plus âgés, parmi
lesquels il y avait des hommes fort honorables comme Wolowsky, Demlutzky,
Matuschefsky et Cherwiesky.
Les plus jeunes, et je parle
surtout de mes camarades de chambre, se montraient religieux dans
leur propos mais n'avaient pas un comportement rigoureux malgré
la sévérité de la moralité ambiante.
La fréquentation entre hommes et femmes n'existait pas et
le mariage était strictement interdit.
On ordonna même,
dans une Bisjoke (Sic), que ceux qui se sentaient attirés
par une femme devaient se faire donner 10 coups de verge.
Et, à
ma grande surprise, presque tous les jeunes gens se les laissaient
administrer.
À ce propos, il faut remarquer que presque tous
les jours, ces visions (sic) étaient proclamées par
l'un des trois maîtres et qu'on les consignait dans un livre
dont on faisait des copies.
Tous les jours les jeunes gens étaient
entraînés par un maître d'exercice polonais.
Cependant tous les fusils et les sabres furent cachés quand
les Français entrèrent à Offenbach en 1799.
Pendant l'été 1798, trois des fils de Jonas Wehli
et mon plus jeune frère Juda Léopold arrivèrent
à Offenbach.
Les Wehli étaient des jeunes gens instruits
et bien élevés.
Ils s'appelaient Abraham, Jontef et
Ekiba et reçurent les noms de Joseph, Ludwig et Max.
Mon
frère reçut le nom de Carl le jeune.
Il avait 17 ans
et manquait d'assurance.
On lui ordonna de prendre des leçons
de coiffure.
À l'automne de la même année, mon
bon père vint nous voir en compagnie de messieurs Jonas et
Aron Beer Wehli.
J'étais fou de joie de revoir mon père
bien-aimé.
Ces trois messieurs, honorables et érudits,
furent accueillis solennellement par tous les Maninim et furent
présentés le lendemain matin aux hauts personnages.
Ils déposèrent des offrandes aux pieds de la Gewira
; en or pour les Wehli, ce qui fut particulièrement apprécié.
C'étaient des gens fortunés.
Mon brave père,
qui avait des moyens limités, apporta une pièce de
batiste.
Ce présent fut à l'origine du doute qui commençait
à naître en moi.
Malgré l'exaltation de ma foi,
je commençai à remarquer, puis à être
persuadé, que tout ici n'était que tromperie.
C'était à cause de leur exaltation que des centaines
de braves gens, venus de cent lieues à la ronde, se retrouvaient
exploités, s'appauvrissaient et devenaient malheureux.
La
même année, Monsieur Salomon Zerkowitz, qui était
jadis très fortuné, vint à Offenbach.
Il apporta
encore des biens, mais on lui ordonna de les sacrifier. C'étaient
principalement des obligations de l'État autrichien, que
je dus aller négocier à Francfort, chez le vieux Rothschild,
contre des espèces. Monsieur Zerkowitz était un homme
bon et honnête, et il pleura lorsqu'il dut abandonner son
dernier bien.
A côté de la salle à manger, il y avait la chambre
sainte où se trouvait encore le lit et les vêtements
du saint père (c'est ainsi qu'on nommait Jacob FRANK, le
père de la Gewira et de ses frères).
Les fenêtres
de cette pièce étaient occultées et il faisait
sombre : on y priait avec ferveur en s'agenouillant devant le lit.
L'entrée était autorisée toute la journée.
Deux jeunes filles en costume d'amazone avec fusil et sabre montaient
la garde devant l'entrée de la salle à manger.
La
plupart du temps, on réservait cette tâche à
de jeunes et jolies filles.
Comme je l'ai déjà dit, je fus très blessé
par une réflexion faite à table en ma présence
par "saint Joseph", à propos de la faible valeur
de l'offrande de mon père.
On accordait donc plus d'importance
à la valeur du don qu'à celui qui l'offrait.
À
partir de ce moment, je me mis à réfléchir
et à commençai à observer ce qui se passait.
Au début je rejetais ces pensées négatives,
et je tenais pour sacrilège de douter de ce que à
quoi croyaient beaucoup d'hommes savants et de qualité ;
j'allais alors dans la chambre sainte et regrettais.
Mais je trouvai
de nouveau motif à rechute.
Il y avait parmi les occupants
de ma chambre un jeune homme de Dresde du nom de Johann Hofsinger.
Il se rapprocha de moi à ce moment-là.
Après
avoir tâté le terrain, il me laissa comprendre qu'il
n'était pas d'accord avec ce qui se passait et s'était
passé ici.
Lorsqu'il eut la conviction que je n'allais pas
le dénoncer, il m'avoua finalement qu'après mûre
réflexion il en était arrivé à la conclusion
qu'il s'exerçait ici une incroyable imposture et que les
croyants qui se trouvaient ici avaient fait de tels sacrifices qu'ils
ne pouvaient pas accepter l'idée que tout n'était
que tromperie.
Ils se retrouvaient dépouillés de tout
moyen de retourner dans leur lointain pays.
Après de nombreuses
discussions, nous prîmes la décision de fuir.
Nous
étions sans moyens et sans le moindre sou vaillant, et Hofsinger
proposa d'utiliser des moyens qui n'étaient pas compatibles
avec l'honnêteté et la réputation de ma famille.
J'écrivis à mon frère, le Dr. Porges,
et le mis au courant de ma décision de quitter Offenbach.
Je lui demandai de m'indiquer une maison à Francfort où
nous pourrions trouver un refuge et les moyens nécessaires
à la poursuite de notre voyage.
La réponse ne se fit
pas attendre.
Ma famille se réjouissait de notre décision
et nous donna le nom d'un certain Monsieur Neustadtl à Francfort
où nous aurions de l'argent et où nous serions accueillis
amicalement.
Nous commençâmes alors les préparatifs
sérieusement.
Je mis mon frère au courant de mon projet
et lui montrai la lettre de notre frère ; il se déclara
immédiatement d'accord de me suivre en tout.
Nous nous consultâmes
alors pour savoir comment nous allions quitter Offenbach.
Nous décidâmes
de le faire tôt, vers 4 heures du matin, en passant par le
jardin.
Nous prîmes cette décision parce que, peu de
temps auparavant, un Polonais de la communauté fut repris
et puni.
Comme c'était souvent notre tour de garde la nuit,
je m'arrangeai pour que se soit Hofsinger et moi qui soyons de garde.
N'ayant pas beaucoup de bagages, nous en fîmes un baluchon.
Le soir, avant notre fuite, je fus appelé par une femme de
chambre chez la Gewira.
La nuit était déjà
tombée quand j'entrai dans le cabinet.
Le chien favori, un
lévrier, qui me connaissait et n'aboyait jamais en ma présence,
m'attaqua violemment.
L'heure inhabituelle de la convocation et
l'attaque surprenante du chien m'effrayèrent : je nous crus
découverts et dénoncés.
Je tombai à
genoux.
La Gewira ordonna au chien de se taire en disant :
"
Qu'as-tu aujourd'hui, tu ne reconnais pas mon cher Carl ?"
Elle s'adressa alors à moi en polonais :
" J'ai remarqué
que ton uniforme était usé ;
tu peux aller demain
à Francfort t'en commander un autre".
Elle me demanda
si je n'avais pas d'autres souhaits.
J'étais très
touché et, repentant, j'aurais presque tout avoué
devant de telles faveurs et grâces.
Elle me donna sa main
à baiser et me congédia.
Je m'éloignai en pleurant,
car je respectais et aimais cette grande dame ; j'avais 19 ans à
l'époque.
À minuit, je fus remplacé par un
autre garde et partis me reposer.
Vers deux heures, nous dûmes
nous lever et empaqueter nos quelques vêtements et linges
; j'évitai de prendre ce que je n'avais pas apporté.
Hofsinger et mon frère en firent de même.
À
quatre heures, je pris de nouveau la garde avec Hofsinger.
Nous
avions déjà nos bagages avec nous.
Nous étions
de faction dans le corridor du rez-de-chaussée devant les
appartements de saint Bernard et saint Joseph.
Lorsque mon frère
descendit l'escalier, nous mîmes nos fusils dans un coin et
allâmes dans la cour, le cœur battant et dans la plus
grande excitation, exposés au danger d'être retenus
par le cocher ou les valets d'écurie.
De là nous atteignirent
le jardin en passant par-dessus la palissade en bois et nous étions
libres.
Nous nous dirigeâmes vers le bois tout proche, arrivâmes
à Oberrad puis à Francfort vers six heures.
Nous nous
mîmes aussitôt à la recherche de Monsieur Neustadtl.
Il nous reçut très aimablement, nous offrit le gîte
et le couvert et nous donna l'argent qu'il avait reçu de
notre famille.
Le jour même, mon frère et moi allèrent
nous acheter quelques vêtements.
Le lendemain matin nous pûmes
trouver un transport pour Seligenhof, puis, par la forêt du
Spessart, nous arrivâmes à Eselbach où nous
passâmes la nuit.
Avant cela nous eûmes très
peur d'être dévalisés par plusieurs hommes qui
sortirent de la forêt en nous barrant la route.
Notre cocher
s'arrêta et nous montra en tremblant les hommes qui s'alignaient
sur la route.
Nous entendîmes alors derrière nous sonner
un postillon qui se rapprochait rapidement.
Les hommes retournèrent
dans la forêt et nous poursuivîmes notre chemin en compagnie
de la diligence jusqu'à Eselbach.
Nous fûmes avisés
par notre famille que nous devions nous rendre à Fürth
et y attendre d'autres instructions.
D'Eselbach à Fürth,
nous fîmes le voyage à pied, en passant par Würzburg.
Sur la route d'Eselbach à Würzburg, je sentis brusquement
une faim terrible me ronger et m'affaiblir à tel point que
je ne pus continuer et dus m'allonger.
Heureusement des paysannes
qui arrivaient par là me donnèrent un morceau de pain.
Plus tard les médecins me dirent que si l'on ne m'avait rien
donner à manger, je ne me serais plus relevé et serais
mort.
Arrivés à Fürth, nous nous logeâmes
dans une auberge. Hofsinger était absolument sans moyens
et il fallut l'entretenir avec l'argent que nous avions reçu
de notre famille à Francfort.
Je dois dire ici qu'Hofsinger
avait commis une malhonnêteté à Offenbach avant
notre départ.
Il s'était emparé des clés
du coffre de messieurs Joseph Wehli et Johann Klarenberg, que ce
dernier cachait sous l'oreiller sur lequel il dormait, pour s'approprier
le livre des visions et une jaquette en toile.
Il dut me donner
le livre, car il aurait pu en faire mauvais usage. Hofsinger recommença
à Fürth ce qu'il avait fait à Offenbach ; il
me reprit pendant la nuit le livre des visions que je cachais sous
mon oreiller, s'en alla et ne revint plus.
Il vendit le livre au
gendre de Monsieur Zerkowitz qui habitait Fürth, lequel n'en
fit pas mauvais usage.
Nous avions des lettres de recommandation pour plusieurs personnes
à Fürth, parmi lesquelles Monsieur Moses Gosdorf, un
des plus connus.
Nous y fûmes très aimablement reçus
et ils nous invitèrent à leur table.
Nous reçûmes
de la maison l'ordre de rester à Fürth jusqu'à
ce que nous recevions les instructions de rentrer au pays.
Nous
restâmes à Fürth pour les fêtes de Pentecôte.
Après les fêtes, nous reçûmes une convocation
de la police nous enjoignant de quitter Fürth dans les 48 heures.
J'appris que c'était à la demande du conseil administratif
Juif.
Monsieur Gosdorf m'apprit que nous étions expulsés
parce que je m'étais fait raser avec un rasoir.
Rien n'y
fit, il a fallut partir.
Nous allâmes dans un faubourg de
Nürnberg, car la ville n'autorisait pas les Juifs à
y séjourner.
Nous allâmes chercher à Fürth
les lettres de la maison que nous nous y étions fait adresser.
Enfin nous fûmes autorisés à rentrer au pays,
et nous nous mîmes en route immédiatement.
Lorsque
nous arrivâmes dans le dernier village Bavarois avant la frontière,
je reçus une lettre me disant de ne pas traverser la frontière,
car nous risquions de nous faire engager comme recrues.
On nous
demandait d'aller à Bayreuth et une lettre de recommandation
pour un certain Monsieur Engel était jointe au courrier.
Il faut que je raconte ici l'incident survenu à Gostenhof,
un faubourg de Nürnberg.
Nous étions dans une auberge
pour notre repas de midi, qui consistait en un verre de bière
et du pain beurré, et un client, visiblement Juif, demanda
si nous étions Juifs.
Sur ce, il se mit à proférer
des insultes et nous lança une malédiction : c'était
une Misse Meschine (insulte de mort) parce que nous mangions
avec un couteau et du beurre d'un goy.
J'appelais l'aubergiste et
lui dit que le Juif m'insultait parce que je me servais de son couteau.
" Est-ce donc si peu propre chez vous ? "
Sur quoi l'aubergiste
empoigna les Juifs et les mit dehors.
Nous allâmes directement à Bayreuth où nous
arrivâmes le lendemain matin.
Monsieur Engel, un bel homme
imposant, nous reçut aimablement et, après avoir lu
la lettre de recommandation, nous invita à loger chez lui.
On nous prépara deux belles chambres bien meublées,
et cet homme honorable nous offrit le petit déjeuner, le
repas de midi et le repas du soir.
Il regrettait de ne pouvoir nous
recevoir à sa table parce qu'il était en profond deuil
de son épouse, qu'il avait aimée infiniment, qui était
belle et aimable et dont la perte le rendait inconsolable.
Nous
nous plaisions beaucoup chez Monsieur Engel et le séjour
à Bayreuth était fort agréable.
Nous vîmes
rarement Monsieur Engel.
Après un séjour de quatre
semaines, Monsieur Engel m'appela et me dit qu'il était surprenant
que des jeunes gens aient une vie oisive et sans occupation.
C'est
pourquoi il s'était adressé à un ami à
Hambourg et m'avait même déjà obtenu un emploi,
que je pourrais occuper immédiatement.
Je le remerciais pour
sa bonne intention, mais qu'il me fallait d'abord demander l'accord
de mes parents. Comme celui-ci ne vint pas, mais qu'on nous donna
au contraire l'espoir de pouvoir bientôt retourner à
la maison, je le dis à Monsieur Engel, qui déclara
que nous devions quitter sa maison, puisque nous refusions sa proposition
bien intentionnée.
Il me promit une lettre de recommandation
pour Monsieur N., un de ses amis propriétaire d'un domaine
à Emet, près de Burgkundstadt, qui nous recevrait
avec plaisir.
Nous prîmes la route par une journée très chaude
du mois d'août. Vers midi nous arrivions à Burgkundstadt.
Avant d'arriver en ville j'enlevai ma veste et la mis sur le sac
de voyage que je portai.
J'avais dans la poche de ma veste une petite
bourse contenant environ 40 florins.
Il y avait entre Burgkundstadt
et Emet une sérieuse côte à grimper.
Nous étions
à mi-côte lorsque je demandai à mon frère
Léopold, qui marchait derrière moi :
"Ma veste est-elle toujours sur le sac de voyage?"
"Non, tu l'as perdue!"
Ce fut pour moi comme un coup de tonnerre.
L'argent qui se trouvait
dans la veste était tout ce que nous possédions.
Je
me laissai tomber par terre, ne pouvant plus me tenir debout.
Mon
frère Léopold dévala la côte jusqu'à
Burgkundstadt, se renseignant auprès de tous ceux qu'il rencontrait,
mais sans succès.
Il était à la porte de la
ville lorsque quelqu'un lui demanda ce qu'il cherchait et qu'il
le lui dit ; il le conduisit alors chez un tanneur qui avait trouvé
la veste.
Au début ce dernier ne voulut pas le reconnaître.
C'est lorsque Léopold insista et qu'il lui expliqua à
quel point nous étions malheureux et misérables, que
le tanneur apporta la veste et la bourse qui se trouvait dans la
poche.
Il fallut donner au tanneur quelques florins de récompense.
Ma joie fut indescriptible lorsque je vis mon frère grimper
la côte en courant, tenant la veste à bout de bras.
L'après-midi nous arrivâmes au petit village d'Emet.
J'allai immédiatement au château pour remettre ma lettre
à B..
On m'envoya au jardin où je trouvai deux hommes,
l'un vêtu de blanc constellé d'étoiles, l'autre
en robe de chambre.
Ce dernier me demanda ce que je désirai
:
" J'ai une lettre à remettre à Monsieur le
Baron. "
Il la prit et la décacheta. C'est alors que
l'autre personne s'approcha, regarda la lettre et demanda :
" Qui t'écrit en t'appelant cher ami? "-
" C'est un certain Monsieur Engel de Bayreuth. "
" Quoi? un Juif ose t'appeler ami ? "
Le Baron, embarrassé, dit :
" Cet Engel est un ami du
ministre Hartenberg."
Le Baron me demanda de revenir le lendemain.
Lorsque je me présentai
le jour suivant, il me reprocha de lui avoir remis la lettre en
présence de son frère, le Reichshofrath (haut fonctionnaire
d’État).
Il parla avec moi en jargon Juif et finalement
il me dit :
"Mon ami Engel vous a chaudement recommandé à
moi.
Je suis donc prêt à vous accueillir ici.
Vous
pouvez construire une maison ici, y faire du commerce
et je construirai
un Beschaim Juif où vous pourrez vous faire enterrer."
Nous nous sentions totalement abandonnés dans ce village
misérable.
Il y avait quelques familles juives très
pauvres, dont l'une, originaire de Bohême, nous témoigna
quelque sympathie.
Lorsque nous annonçâmes que nous
attendions incessamment un courrier de la maison qui nous demanderait
de rentrer, on nous conseilla de prendre des Pletten, c'est-à-dire
des schnorren comme les voyageurs sans argent, dans les communautés
juives environnantes.
Ce conseilleur insista tellement que nous
finîmes par accepter d'essayer.
Il nous inscrivit les noms
des villages où il y avait des communautés juives
et nous voilà partis.
À la première tentative,
nous nous sentions déprimés et honteux.
Au............... on dut pour le................... chercher l'hôte.
[illisible dans le texte]
Ce sont généralement des marchands de bestiaux qui
sont absents pendant la semaine.
On est reçu par la ménagère,
on vous donne le soir une soupe, du pain et une couche pour la nuit,
puis de nouveau une soupe le matin et quelques Kreutzers.
Nous en
eûmes bientôt assez et renonçâmes.
Une
lettre que nous reçûmes de la maison nous demanda de
nous rendre à Bamberg, et de nous y présenter au président
de la communauté juive, Monsieur Abraham Neuzedlitz, pour
qui une lettre de recommandation était jointe.
Nous prîmes
tout de suite la route.
Nous étions en septembre 1800.
Nous
nous approchions du front.
Les Français avaient dépassé
Regensburg et les Autrichiens étaient à Bamberg.
Les
villages que nous traversions étaient occupés par
les soldats autrichiens.
Nous arrivâmes tard le soir dans
un assez grand village des environs de Bamberg.
Nous voulûmes
rentrer dans une auberge mais fûmes renvoyés de la
première, puis de la seconde. L'aubergiste de la troisième
voulut également nous renvoyer ; c'était un vieil
homme, à qui nous reprochâmes de nous rejeter ainsi,
en pleine nuit, dans les intempéries.
Nous insistâmes
longuement il dit nous dit que nous devions être des espions
français.
Nous avions beau lui assurer que nous étions
Autrichiens : il ne voulait pas nous croire.
Après cela,
nous lui dîmes que nous étions Juifs.
"Montrez-moi
les dix commandements!"
Nous ne pouvions pas les montrer, parce
que nous ne les avions pas.
L'aubergiste apporta alors une miche
de pain et dit
"Comment cela se dit-il en hébreu? "
" Lechem ", dis-je
et le bon vieux fut satisfait.
Nous
nous restaurâmes avec Lechem, beurre et bière.
Le lendemain
midi nous arrivâmes à Bamberg et allâmes immédiatement
porter notre lettre de recommandation à Monsieur Abraham
Neuzedlitz.
Dès qu'il eût lu la lettre, il nous accueillit
amicalement et nous invita à loger chez lui.
C'était
un vieil homme simple, hospitalier et charitable qui était
typiquement Juif dans sa façon de s'exprimer et de s'habiller.
Il nous invitait à sa table tous les samedis et jours de
fête.
C'était un homme honnête et pieux.
Lorsqu'il
rentra de la synagogue le jour du Grand Pardon, il nous demanda
de l'accompagner au grenier pour levune mekadisch, c'est-à-dire
pour sanctifier la lune par une prière, ce que nous n'avions
encore jamais fait.
Lorsque le brave homme se mit à parler
dans son hébreu ashkénaze, nous dûmes retenir
notre rire.
Mais quand il se mit à bondir et à sautiller
pour le shalom alechem, nous n'en pouvions plus et notre
fou-rire éclata avec force.
Le brave vieillard se figea de
surprise, sortit, et nous enjoignit le lendemain matin de quitter
sa maison.
Nous reçûmes alors de chez nous une lettre nous demandant
de nous rendre à Leipzig où se tenait alors la foire,
et, selon les possibilités, soit de rentrer à la maison,
soit d'aller à Francfort sur Oder où nous avions de
la famille.
Nous prîmes la route tôt dès le lendemain,
pour arriver à Bayreuth le soir.
Nous atteignîmes le
soir même le dernier village avant Bayreuth. il y avait là
un aubergiste sur le pas de sa porte qui nous déconseilla
de poursuivre notre chemin car l'orage menaçait.
Nous le
remerciâmes du conseil en pensant qu'il voulait seulement
que nous nous arrêtions chez lui, et nous continuâmes
à marcher.
Après à peine une heure un quart
de marche, l'orage éclata avec une grande violence et le
ciel devint si sombre que nous nous écartâmes de la
route.
Nous nous trouvions dans un petit bois où l'on avait
déraciné des arbres ; nous nous enfoncions jusqu'aux
hanches dans des trous et étions totalement trempés
: par en haut par la pluie battante et par en bas par l'eau qui
remplissait les trous.
Nous errâmes assez longtemps puis nous
aperçûmes au loin une lumière vers laquelle
nous nous dirigeâmes.
En nous approchant, nous trouvâmes
une auberge d'où sortait une musique bruyante.
La patronne
vint vers nous dans le couloir et nous dit qu'elle ne pouvait pas
nous héberger parce qu'elle n'avait pas de place et que nous
ne pourrions pas nous reposer en raison du mariage que l'on célébrait
et qui allait se poursuivre toute la nuit.
Elle nous conseilla de
continuer jusqu'à la Phantasie où nous nous trouverions
à nous loger et où nous passerions une nuit calme.
La Phantasie était un parc d'attraction proche de Bayreuth.
Lorsque nous arrivâmes, l'aubergiste était tout seul,
car sa famille était en ville.
Il n'y avait pas non plus
de clients.
Nous étions, comme je l'ai déjà
dit, trempés jusqu'aux os. Je demandai à l'aubergiste
d'allumer le poêle, ce qu'il fît, et, à défaut
d'autres choses, je commandai pain, beurre et bière.
Léopold
ne voulut pas manger et il préféra se réchauffer.
J'avais à peine avalé quelques bouchées que
j'entendis un grand coup.
Je me retournai et vis mon frère
allongé par terre, sans connaissance.
J'appelai l'aubergiste
et lui demandai d'aller chercher un médecin, mais Il me dit
qu'il n'y en avait pas dans les environs.
Nous transportâmes
mon frère sans connaissance dans une chambre du premier étage,
nous le dévêtîmes et dûmes couper ses bottes
sur ses pieds......
[le mémoire s'arrête là...]
Traduction du manuscrit original
en Allemand gothique conservé au Leo Baeck Institute de New York
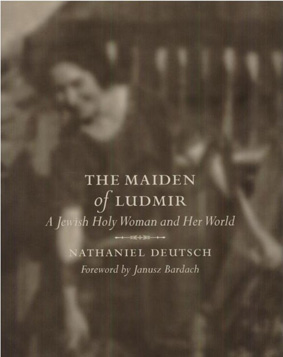 |
Hannah Rochel Verbermacher, a Hasidic
holy woman known as the Maiden of Ludmir, was born in early-nineteenth-century
Russia and became famous as the only woman in the three-hundred-year
history of Hasidism to function as a rebbe--or charismatic
leader--in her own right.
Nathaniel Deutsch follows the traces
left by the Maiden in both history and legend to fully explore
her fascinating story for the first time.
The Maiden of Ludmir
offers powerful insights into the Jewish mystical tradition,
into the Maiden's place within it, and into the remarkable
Jewish community of Ludmir.
Her biography ultimately becomes
a provocative meditation on the complex relationships between
history and memory, Judaism and modernity.
History first finds the Maiden in the
eastern European town of Ludmir, venerated by her followers
as a master of the Kabbalah, teacher, and visionary, and
accused by her detractors of being possessed by a dybbuk,
or evil spirit.
Deutsch traces the Maiden's steps from Ludmir
to Ottoman Palestine, where she eventually immigrated and
re-established herself as a holy woman.
While the Maiden's
story--including her adamant refusal to marry--recalls the
lives of holy women in other traditions, it also brings to
light the largely unwritten history of early-modern Jewish
women.
To this day, her transgressive behavior, a challenge
to traditional Jewish views of gender and sexuality, continues
to inspire debate and, sometimes, censorship within the Jewish
community.
Nathaniel Deutsch, The Maiden of Ludmir
A Jewish Holy Woman and Her World
An S. Mark Taper Foundation Book in Jewish Studies
978-0-520-23191-7 |
|
|
More about Jacob Frank and
the Frankists, here

|